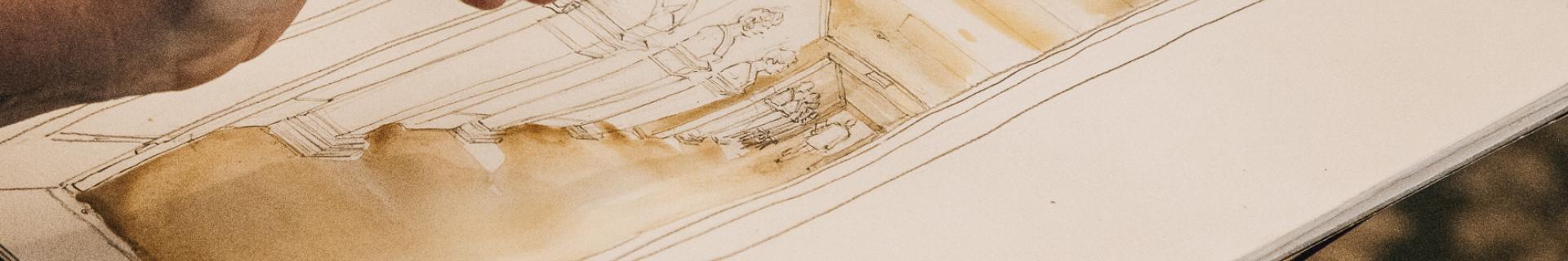
Une Journée à l’Académie des Beaux-arts avec François-Bernard Mâche
Dans le cadre d’Une Journée à l’Académie, colloque organisé par son confrère François-Bernard Michel, l’académicien musicologue et compositeur François-Bernard Mâche, élu au fauteuil de Iannis Xenakis en décembre 2002 présente au public invité ses réflexions sur la notion d’œuvre d’art. Est-elle aujourd’hui une notion obsolète ? Une question complexe dans laquelle le compositeur convoque la musique comme les arts visuels estimant les démarches artistiques assez proches. Canal Académie vous propose d’écouter la retransmission de sa communication prononcée le 28 novembre 2012, à l’Académie des beaux-arts.
François-Bernard Mâche est né en 1935 dans une famille de musiciens de plusieurs générations. Depuis 1993, il est Directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ancien élève de l'École Normale Supérieure de la rue d’Ulm dans la section des Lettres, il a mené et mène en parallèle une activité d'écrivain, de critique, de traducteur et de compositeur de renommée internationale, ce que les non initiés en musique contemporaine savent et que nous ignorons pour la plupart d'entre-nous. La retransmission de sa communication est ponctuée d'extraits musicaux de sa composition dont vous trouverez les références au bas de cet article, à la suite de la transcription du texte de son intervention. Guy Boyer, le rédacteur de Connaissances des Arts était le modérateur des débats de cette journée exceptionnelle où l'Académie des beaux-arts s'est ouverte aux représentants du monde de l'art, institutionnels, critiques et artistes pour faire partager ses réflexions sur l'art aujourd'hui, une initiative du Professeur Michel, membre de l'Académie dans la section des membres libres.
Cette journée organisée par l'Académie des beaux-arts a fait l'objet d'un partenariat entre Canal Académie, Connaissances des arts et Radio Classique concernant la diffusion et la communication de cette journée inhabituelle à l'Académie, une Première dont le succès invite les organisateurs a récidiver. A suivre, l'an prochain, l'idée d'un nouveau rendez-vous ayant été évoqué.
Texte de François-Bernard Mâche, membre de la section de composition musicale, de l'Académie des beaux-arts
L’œuvre d’art, une notion obsolète ?
Les réflexions dont je vais vous faire part concernent en majorité les arts visuels. Étant compositeur, je n’ai cependant pas d’autre légitimité pour en parler que celle de n’importe quel spectateur. Mais d’une part beaucoup de plasticiens actuels n’en demandent pas plus, et par ailleurs la démarche artistique a peut-être un certain nombre de caractères communs, quel que soit le domaine auquel elle s’applique.
Je suis né dans une société où ce qu’était une œuvre d’art semblait admis sans problème par tous. Elle se définissait selon quatre ou cinq critères sur lesquels régnait un apparent consensus. Tout
d’abord l’œuvre d’art ne servait à rien, sinon à donner un plaisir de l’imaginaire chez son auteur comme parmi son public. C’était un jeu, mais un jeu réputé supérieur par sa richesse symbolique.

En second lieu, l'œuvre d’art procédait d’une compétence exceptionnelle. L’artiste se distinguait des autres ouvriers par une virtuosité rare, à laquelle peu pouvaient accéder, et qui nécessitait une formation difficile. Son travail ne pouvait en aucun cas être confondu avec une production de la nature due au hasard.
L'œuvre d’art s’évaluait selon son originalité. Elle devait surprendre au point d'infléchir les goûts, de modifier la sensibilité et même le cours de l'histoire. Baudelaire a écrit : « Le beau est toujours bizarre », et « créer un poncif, voilà le génie ». L'œuvre d’art était une sorte de message inattendu, mais qui finissait par atteindre tout le monde.
Étant originale, l'œuvre était unique par essence, et la rareté garantissait sa valeur. Lorsque les techniques ou les circonstances permettaient sa multiplication ou sa réitération : imprimerie, concerts,
reproduction… son unicité se réfugiait dans une signature autographe, ou dans la limitation volontaire du nombre d’exemplaires, ou même dans la destruction des moules, des négatifs qui auraient permis
une prolifération indéfinie.
Enfin l’œuvre d’art visait à être universelle et pérenne. Plus elle transcendait les limites de sa culture et son époque d’origine, plus elle était considérée comme accomplie. Le chef d’œuvre devait s’imposer à un public sans cesse élargi, et à une postérité pour qui il prendrait valeur de classique.
Voilà qu’au cours du XXe siècle, aucun de ces critères n’est resté indemne. Comme observateur, et parfois comme complice, j’ai été impliqué avec beaucoup d’autres dans leur contestation ou leur rejet.
La rupture, la provocation sont devenues l’expression habituelle, et presque un devoir, de l’innovation artistique. Elles découlaient à vrai dire d’une antique tradition. La naissance de l’artiste en
tant qu’individu avait déjà suscité dans la Grèce antique le nihilisme qui, en 356 avant notre ère, avait poussé Érostrate à brûler le temple d’Éphèse, une des sept Merveilles du Monde. Et sa provocation
avait si bien réussi que malgré l’anonymat auquel on avait condamné ce criminel, cet artiste raté, son nom a mieux survécu que ceux des trois architectes, (Théodore de Samos, Ctésiphon et Metagenès).
Sartre le souligne dans sa nouvelle du recueil Le Mur. Reste d’ailleurs à prouver que cette survie du nom est d’une importance comparable à celle d’une œuvre d’art…
La rupture provocante s’est propagée de siècle en siècle avec plus ou moins d’intensité. Le Caravage et Monteverdi l’ont illustrée il y a 400 ans. Elle a affecté le sujet du poème avec « Une charogne » de Baudelaire, la représentation des formes dans les dernières toiles de Turner, les conventions sociales avec « le déjeuner sur l’herbe » de Manet, ou certaines frontières habituelles dans les collages de Victor Hugo. L’atonalité en musique apparaissait chez Liszt dès 1885 avec sa Bagatelle sans tonalité, et chez Abel Decaux avec son Clair de lune, en 1900, bien avant d’être érigée en système par Schönberg. En peinture, le sujet et même le jeu des couleurs étaient également récusés au cours du même siècle. Permettez-moi de préciser quelques repères :
En 1843, Bertall, dans la revue l’Illustration, présente le dessin d'un tableau noir constellé de points blancs avec pour légende : Vue de la Hougue (effet de nuit), par M. Jean-Louis Petit.
La même année Kierkegaard écrit dans un de ses Diaplasmata : « Le résultat de ma vie est nul ; c’est un vague sentiment, une grisaille. Cela ressemble au tableau de cet artiste qui, pour figurer le passage de la mer Rouge par les Hébreux, recouvrit tout le mur de rouge sous prétexte que les Hébreux étaient passés et les Égyptiens noyés ».
En 1882, année où meurt Bertall, est exposée au Salon des Incohérents une toile de Paul Bilhaud intitulée Combats de nègres dans une cave, pendant la nuit. La toile est entièrement noire, encadrée d'or.
Ce gag amuse Alphonse Allais qui le reprend à son compte, en exposant l’année suivante deux cartons : le premier est une feuille de bristol blanc, intitulé Première Communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige - le second est tout bleu… Puis en 1885, il récidive, en rouge cette fois, avec : "Récolte de la tomate, sur le bord de la mer Rouge, par des Cardinaux apoplectiques". En 1887, il rassemble ses œuvres monochromes, parmi lesquelles figure une partition qui est une page vierge de 3 portées, chacune de 3 mesures, intitulée Marche funèbre pour les funérailles d'un grand homme sourd. (Il explique que si elle est vierge, c’est parce que les grandes douleurs sont muettes).
Beaucoup d’autres manifestations parisiennes d’humour absurde accompagnent pendant une décennie (1882-1892) cette mode de l’Incohérence. Eugène Bataille expose par exemple en 1887 une « Joconde fumant la pipe ».

Quelle différence y a-t-il entre les monochromes du XIXe siècle et ceux d’Yves Klein à partir de 1957 ? On est tenté de répondre d’abord : 72 ou 114 ans. Entre la toile vide de Bilhaud en 1882 et le
carré blanc sur fond blanc de Malevitch : 36 ans. Entre la Joconde fumeuse de Bataille et celle à moustache de Duchamp : 32 ans. Faut-il alors donner raison à Gérard de Nerval lorsqu’il disait: « Le premier qui a comparé une femme à une rose était un poète, et le second un imbécile » ?
Les choses sont plus complexes, et ne peuvent être ramenées ni à la répétition d’une plaisanterie consacrée, ni à une surenchère induite par l’individualisme de l’artiste. Une première différence essentielle entre le XIXe et le XXe siècle est l’humeur qui accompagne ces propositions esthétiques. Les plus anciennes sont d’un humour généralement très joyeux, (même si celui de Kierkegaard fait un peu exception). Tandis que celles du XXe siècle sont de plus en plus sérieuses, voire désespérées. Dada s’amuse encore un peu dans les années 20, mais dans l’art qui aujourd’hui se prétend conceptuel c’est beaucoup plus rare. Les futuristes italiens ont exalté l’innovation comme la
valeur artistique suprême, souvent avec plus de sérieux dans l’audace prophétique que de talent. Pour Marinetti en 1913, les bruits de la guerre moderne composent de superbes symphonies. Stockhausen,
près d’un siècle plus tard, a osé qualifier le pire attentat du 11 septembre 2001 d’exceptionnelle œuvre d’art.
Cela nous ramène aux définitions que j’ai proposées de ce terme. Les provocations, les ruptures sont-elles l’outil grâce auquel l’histoire de l’art progresse par des séismes successifs, ou visent-elles à annihiler l’art en le dénonçant comme une illusion pieuse ou néfaste ? Duchamp est-il l’héritier d’Érostrate ? Le premier critère évoqué, de l’art comme un jeu suprême, est directement concerné par certaines manifestations. N’importe quoi peut servir de jouet, mais finalement on peut ne plus avoir envie de jouer du tout. La déclaration de Lautréamont : « la poésie doit être faite par tous, non par un" peut au choix se lire comme un magnifique élan collectif qui fera accéder chacun au talent artistique, ou comme une dévaluation radicale de l’art. Duchamp avait ironiquement bien prévu les deux démarches d’une part en faisant semblant de sacraliser la banalité d’un porte-bouteilles, mais aussi, on l’oublie parfois, en préconisant le « ready-made inversé » qui consisterait, par exemple, à utiliser un Rembrandt comme planche à repasser.
Il reste que le répertoire des gestes disponibles n’est peut-être pas plus infini que celui des formes, et que la plupart des actions qui se veulent aujourd’hui transgressives ont un air de déjà-vu assez décevant. Après Manzoni (boîtes de merda d’artista, 1961), il est plus difficile de remettre sur le marché de l’art des gestes qui le tournent aussi bien en dérision. Ce qui manque généralement à celles des manifestations de l’art dit « conceptuel » qui s’inscrivent à la suite des gestes à la Manzoni, plus encore qu’un vrai talent philosophique supposé remplacer l’imagination plastique, c’est l’humour, ou la vitalité. Le constat aboutit dans plusieurs cas à une résignation réactionnaire. La plupart des aspects du post-modernisme qui s’est développé à partir des années 1980 sont majoritairement, surtout en musique, des retours, désireux de gommer les illusions du progressisme, de la fuite en avant du dernier siècle, et pour cela de renouer avec des recettes encore plus obsolètes que le nouvel académisme des formalistes post-sériels ou de beaucoup d’ « installateurs », héritiers infidèles de Duchamp.
Infidèles, car le geste du ready-made perd l’essentiel de son sens en se fétichisant. Si la création d’un poncif peut être une marque de génie, son usage, lui, ne peut qu’être une routine artisanale, ou la preuve d’imbécilité dénoncée par Nerval. D’où sans doute la contestation assez généralisée de deux autres critères que j’avais cru observer à propos de l’œuvre d’art : la compétence de l’artiste, et sa radicale différence avec l’artisan.
Le carré noir sur fond blanc de Malevitch en 1915 et « Fontaine », l’urinoir signé Richard Mutt par Duchamp en 1917, n’ont pu rafraîchir brutalement le regard et la sensibilité qu’une seule fois. En
passant du statut de geste à celui d’œuvre, et en cédant à l’impératif commercial de la signature, ils sont inévitablement rentrés dans le jeu qu’ils entendaient ridiculiser ou dénoncer. En 1964 Duchamp a
reconstitué en une série d’exemplaires, signés de son vrai nom et numérotés, le prototype perdu. Il se conformait ainsi finalement aux lois ordinaires du commerce d’art. Le dernier exemplaire s’en est vendu en 1999 pour 1,6 millions d’euros (soit plus de 2 millions de dollars). Warhol, Arman et bien d’autres n’avaient pas hésité à se soumettre à ce jeu ambigu de récupération réciproque depuis quelques
années.

Beaucoup plus fidèle au sens profond du ready-made a sans doute été l’action du 25 août 1993 au Carré d’art de Nîmes. Un certain Pierre Pinoncelli, provocateur obstiné, a fait d’un de ces urinoirs l’usage initialement prévu, conclu par un violent coup de marteau. Soumis à un procès en correctionnelle, il a fait valoir qu'il s'agissait « d'achever l'œuvre de Duchamp, …, En réponse à la provocation inhérente à la présentation de ce genre d'objet trivial dans un musée…y uriner termine l'œuvre et lui donne sa pleine qualification ». Il a néanmoins été sanctionné par un mois de prison avec sursis et 286.000 F de dommages et intérêts. Cela ne l’a pas dissuadé de récidiver le 4 janvier 2006 au Centre Georges Pompidou, qui présentait lui aussi une rétrospective Dada. Lors du procès, un avocat général sensé a estimé la valeur de l’objet détérioré à 83 €, sa valeur de remplacement sur les catalogues usuels d’objets sanitaires. Le Musée d’Art Moderne, lui, réclamait 2,8 millions d’euros, correspondant aux dernières transactions concernant les pièces de cette série. Le verdict a été de 3 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l’épreuve, et 214.000 € de dommages et intérêts, ramenés cependant en appel à 14.532 €. Le tribunal qui en 1857 avait condamné Les fleurs du mal de Baudelaire l’avait fait au nom de la morale bourgeoise. Celui de 1993 et celui de 2006 ont condamné le happening de Pinoncelli au nom du commerce d’art. Dans les deux cas, une même incompréhension de ce qu’est réellement l’art – un questionnement, une aventure, un jeu, et non seulement un objet de jouissance –a été lourdement affirmée au nom de la société.
L’aporie de l’immédiate récupération marchande qui s’applique à la dénonciation elle-même du marché de l’art a condamné beaucoup d’artistes purs à s’évader vers des formes qu’ils pensaient
invendables, bien que coûteuses : land art, happenings etc… On les a tout de même récupérées en vendant les traces photographiques de leurs gestes. Lorsqu’il s’agit, comme chez Yves Klein, de vendre
des espaces immatériels contre des feuilles d’or, ensuite jetées à la Seine sous l’œil des photographes, il s’agit encore d’un acte commercial, mais plus subtil dans sa parodie poétique du désintéressement. Même « désœuvrée », l’œuvre d’art resurgit toujours.
Le quatrième critère de l’œuvre d’art généralement reconnu était son unicité. Elle devait être un jeu non seulement symbolique, mais aussi original, donc essentiellement rare. Dès la Renaissance, les techniques d’impression étaient venues troubler ces deux valeurs, pour le livre et la gravure. Pour que le symbole soit déchiffrable, il faut qu’il corresponde à un imaginaire largement partagé. L’individualisme de l’artiste, garant de son originalité, est entré en contradiction avec un partage des valeurs de plus en plus problématique. La prise de conscience de cette contradiction a conduit certains au cynisme qui accepte que la seule valeur de l’œuvre d’art réside dans une cote commerciale aussi arbitraire que la convention qui inscrit sur un billet de banque dix ou mille unités monétaires.
L’accumulation de produits stéréotypés aboutit à effacer toute valeur. Les 10.000 chansons piratées que peut accumuler un téléphone portable peuvent-elles être assimilées à la phonothèque
d’un mélomane ?
Cette banalisation de l’œuvre d’art comme ersatz illusoire d’une démocratisation entraîne plusieurs conséquences importantes. N’étant plus le produit d’une technique exceptionnelle, ni le résultat d’une quête passionnée, n’importe quel objet brut peut en tenir lieu. L’originalité n’est plus en amont, mais en aval : c’est l’œil ou l’oreille du public qui crée l’œuvre. Mais où ce regard, cette écoute, auront-ils été formés ? Rimbaud, un des premiers, déclarait «dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne, les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs… ». Mais la sensibilité, l’oreille et l’œil de Rimbaud étaient ceux d’un élève surdoué qui pouvait se permettre de chercher ailleurs les aliments de son génie. Il ne légitime nullement l’idée que n’importe qui peut faire n’importe quoi, et ce sera de l’art si on le décide.
Duchamp ou John Cage, à défaut d’être de grands créateurs, étaient au moins de vives intelligences. On peut douter que leurs épigones aient eu raison de considérer comme une leçon ce qui chez eux était plutôt des gestes d’humeur et d’humour, de colère, et de dépit.
L’artiste du XXIe siècle est dans une situation particulièrement difficile. Les censures religieuses ou morales ont largement disparu dans les pays se réclamant de la démocratie. Mais elles ont été souvent remplacées par des objectifs commerciaux qui peuvent encore plus contredire ses valeurs authentiques, et qui, plus généralement, tendent à pervertir la démocratie elle-même en réduisant les pouvoirs politiques à de pures apparences discrètement maintenues sous tutelle. Lorsque l’artiste serait prêt à s’accommoder bon gré mal gré de ces contraintes, comme autrefois ses prédécesseurs pour les exigences du prince, il se heurte au phénomène nouveau de la production de masse de « produits culturels » qui n’ont que de vagues ressemblances avec des œuvres artisanales ou artistiques, et qui accélèrent la disparition des arts populaires. Le public est convié à des transes collectives, à des visites guidées, à des achats, mais presque plus jamais à des actes artistiques. On condescend (difficilement) à lui donner à l’école une esquisse de formation en histoire de l’art, mais en aucun cas une formation artistique. La pauvreté d’imagination et le conformisme des conventions sont les nouvelles données prometteuses du succès commercial. Une connaissance trop intime, vécue, des arts dans le public le comprometrait sans doute. La transgression est devenue une banale exigence publicitaire, et l’impératif d’un nouvel académisme. De plus, elle s’avère de plus en plus difficile à satisfaire, dans une société largement permissive.
Mais il est vrai que les succès les plus commerciaux sont souvent des déclencheurs d’émotions profondes. Ils ne reposent même que sur ces émotions, comme si leur assouvissement impliquait la disqualification puis l’élimination de toute inquiétude authentiquement esthétique. Le kitsch, après avoir été au XXe siècle l’art des dictatures totalitaires, est devenu l’art officiel des démocraties dites « libérales ». Télécommandées par des marchands, des peluches géantes et dérisoires ont pu récemment trôner sous les ors du Château de Versailles. Les décibels de certains concerts rock sonnent
un peu comme des bruits de bottes.
La musique pourrait cependant paraître relativement épargnée, dispensée qu’elle est des enjeux importants du commerce, dont surtout les arts visuels font l’objet. Mais l’industrie de la variété garde, malgré le piratage généralisé et sanctifié, un pouvoir encore considérable, dont les artistes sont loin d’être les principaux bénéficiaires, et dont ils ne sont même pas les vrais fournisseurs. Dans le domaine des musiques industrielles, il n’y a plus beaucoup d’œuvres d’art, mais il y a une foule d’« artistes » : musiciens, danseurs, acteurs, récitants, arrangeurs, rédacteurs, praticiens, tous revendiquent ce statut, et se considèrent parfois avec quelque raison comme supérieurs, malgré l’anonymat, à celui qui signe ou qu’on met sur le devant de la scène. Sans leurs micros, et en amont les techniciens des studios, la plupart des chanteurs de variété seraient aphones. Parmi les minoritaires de la musique classique (à peine 10% du marché, et moins de 1% de cette part pour les compositeurs vivants (ou faut-il dire : survivants ?), la coopération entre instrumentistes, chefs d’orchestre et compositeurs se passe en général assez bien, mais la hiérarchie esthétique est très différente de celle des rétributions : le compositeur gagne souvent moins que les copistes ou les musiciens, qui eux-mêmes gagnent beaucoup moins que le chef d’orchestre.
Autre problème annexe qui concerne tous les arts à des degrés divers, et qui ressortit à la distinction ancienne entre artisanat et art : l’opposition entre amateur et professionnel. Elle a été ouvertement contestée en particulier par Dubuffet et l’Art brut à partir de 1945. Dubuffet déclarait joliment « je suis un peintre du dimanche pour qui tous les jours sont des dimanches ». On dit volontiers
de même que « le professionnel est un amateur qui ne fait que ça ». Si un véritable art populaire de non-professionnels existait encore, on ne pourrait qu’approuver ces formules. Leur humour cache et révèle à la fois que pour exercer pleinement l’amour profond d’un amateur pour son art, il faut nécessairement qu’il devienne professionnel, à moins d’avoir une fortune suffisante pour se tenir à l’écart du jeu social, et devenir son propre mécène. Au contraire, la plupart des artistes à succès, surtout en musique, affirment hautement leur réelle ignorance, dans l’espoir secret de la transformer en un indice de génie purement spontané.
Toute culture se définit par un équilibre spécifique entre innovation et transmission. Après avoir beaucoup innové sans bien réussir à transmettre, notre époque, par un excès inverse, se consacre
à la retransmission indéfinie des mêmes recettes. Même certaines productions normalement vouées à l’éphémère de la mode sont affectées par cette ambiance de fin de jeu, ou de Bas-Empire. D’énormes compilations diffusent sans cesse les répertoires encyclopédiques du passé récent ou ancien, un peu comme des inventaires après faillite.
Il y a cependant peut-être une troisième voie pour sortir de ces impasses. C’est elle que j’essaie de rouvrir en me référant à l’ensemble des siècles et des cultures dont on peut maintenant se faire une image, pour en extraire des universaux transhistoriques. C’est à cette perspective que je vais me référer maintenant. Les problèmes et les contradictions que j’ai évoqués se rattachent en effet tous à une vision de l’histoire qui a été jusqu’au siècle dernier à la base des choix culturels de tradition européenne et de son idéal de modernité. Depuis les révolutions du XVIIIe siècle, et a fortiori depuis Hegel et Marx, l’Histoire a été vécue comme la dimension fondamentale de toute activité humaine. Le souci dominant de nombreux artistes, par-delà même leur banal désir de laisser une trace, a été d’obtenir un verdict favorable en passant devant son Tribunal suprême. Les phénomènes de mode sont une caricature de cette hypertrophie de l’histoire, et la folle vitesse avec laquelle la compétition commerciale exalte et dévalorise simultanément l’innovation aboutit à un immense gaspillage, qui tend à entraîner tout dans son tourbillon.
Une conséquence toute différente de la conscience historique est apparue lorsque l’universalisme naïf hérité du siècle des Lumières et celui plus agressif de l’ère coloniale ont fait place à une découverte des relativités culturelles. Cette découverte semble avoir eu deux prolongements opposés : d’abord la réaffirmation d’une essence idéale des activités artistiques, la recherche exaltée du Beau visant probablement à assurer à l’Europe une suprématie analogue à celle qu’elle manifestait dans ses inventions techniques.
Mais c’est peut-être aussi ce sentiment de relativité qui a légitimé un second credo opposé : la modernité extrême prise comme premier impératif social et culturel du XXème siècle. Puisque l’on découvrait la coexistence de différents systèmes de valeurs culturelles, qu’est-ce qui empêchait d’en créer d’autres de toutes pièces ? On ne croyait plus aussi fermement dans la supériorité unique de la civilisation occidentale, malgré ses succès universels. Les écrits de Frazer ou de Segalen révélaient des perspectives insoupçonnées sur ce qui faisait tantôt différer et tantôt se ressembler tellement de cultures. Mais le goût de l’exploration et de l’inconnu qui avait poussé les Européens hors de chez eux dès la fin du XVe siècle pouvait se perpétuer sans pour autant écraser les autres. Il suffisait d’appliquer la même ouverture inventive à la création de nouveaux ensembles de valeurs, librement
comme Debussy et Gauguin l’ont fait après leur contact avec l’Asie, ou avec des a priori radicaux comme Schönberg ou Kandinsky. Si toutes les cultures pouvaient légitimement prétendre à une reconnaissance, n’importe quel nouveau système de valeurs suffisamment riche et cohérent pouvait soutenir la même revendication. La référence à des cultures encore provisoirement « exotiques » a contribué à déclencher l’explosion de créativité audacieuse qui a marqué les années précédant de peu la première guerre mondiale. Les collections d’art « primitif » amorcées par Rodin, Picasso ou Nolde venaient illustrer à la fois cette prise en considération de l’Autre et, à son contact, une nouvelle légitimation des innovations les plus radicales.
La suite n’a guère fait que développer ou répéter les principaux gestes esthétiques de ce début du XXe siècle marqués par exemple par le renoncement à la syntaxe tonale en musique, à la figuration dans les arts plastiques, à l’unité stylistique, et fréquemment, sous ces révolutions symboliques, par l’espoir ou la hantise d’une révolution sociale. Les années post romantiques refusaient la domination de l’industrie en prenant l’esthétique comme refuge idéal ou symbolique. Le XXe siècle au contraire a décidé de chercher à quel prix il pourrait l’affronter ou l’exploiter. Après un entredeux guerres marqué par cette hésitation sur les stratégies : progressisme révolutionnaire d’un Varèse
ou subversion néo-classique d’un Stravinsky, la fin de la seconde guerre mondiale a vu les nouvelles technologies électroacoustiques et informatiques susciter deux nouveautés importantes : des œuvres
de synthèse sonore et visuelle, tandis que s’étendait à l’infini la disponibilité de toutes les musiques et des répertoires d’images fixes ou animées.
Une des conséquences de l’uniformisation des cultures est, ou va être, une relative stagnation. Un des moyens d’échapper à cette pseudo-fin de l’histoire est de se soucier beaucoup moins des dimensions historiques et plutôt d’inventorier précisément ce qui n’est pas de leur mouvance. L’intercompréhension des cultures conduit à identifier d’abord ce qu’elles ont en partage, pour mieux apprécier ce que chacune a construit d’original sur les grands lieux communs. En arrière-plan, la peur d’une monotonie généralisée, dont l’industrie musicale donne une fréquente illustration.
J’ai publié deux livres et de nombreuses œuvres pour tester l’hypothèse d’une pensée musicale naturelle. Je ne saurais donc la développer ici. Il se trouve qu’un important courant intellectuel parmi des anthropologues, des éthologistes, et des philosophes, converge vers cette remise en question d’un privilège unique de l’espèce humaine. Ils se penchent avec de bonnes raisons sur les origines naturelles de la culture, et mettent l’accent sur un ancrage naturel trop méconnu, ce qui ne fait que rendre plus remarquable tout ce qui donne l’impression – parfois l’illusion - de s’en libérer. Une évaluation sérieuse de cette liberté n’est possible que si l’on interprète sans préjugés socio-biologiques la présence universelle de certains archétypes, et si on en tient un certain compte.
Comme toute musique repose sur un équilibre original entre des formes temporelles identifiables et des variations appréciables sur ces formes, il peut être utile et libérateur de faire sortir la composition du seul champ social ou historique, qui tendrait à figer dans des normes ou des limites ce jeu du Même et de l’Autre. Une définition universelle de l’artiste et de l’œuvre d’art ne peut probablement pas s’imposer, mais l’inquiétude exprimée à travers des éléments symboliques, le goût d’une aventure à la fois spirituelle et sensorielle, la puissance transcendante de l’imaginaire, sont autant de traits qui trouvent en tous lieux et toutes époques à s’illustrer. La table rase historique, que tout un courant des arts du XXe siècle a rêvé d’opérer pour se livrer à des innovations absolues, est peut-être une utopie inutile, si notre psychisme nous fournit déjà spontanément certaines données rudimentaires antérieures à toute routine, et si la sollicitation esthétique, loin d’être d’emblée analogue à un langage, trouve une de ses sources dans les profondeurs animales de ce psychisme. Tout le problème est alors de faire la différence entre un archétype et un cliché, et d’innover avec l’archétype plutôt que contre lui. Mais ce serait là le sujet d’une ou plusieurs autres communications…
L’œuvre d’art a pu être contestée au point d’être évincée au profit de manifestations éphémères où même la modernité était absorbée par la mode, au point que l’Histoire, si obsédante au cours des deux derniers siècles, a perdu toute valeur comme dimension et comme référence. L’œuvre d’art subsiste cependant comme procédant d’un jeu nécessaire et universel et comme une interrogation émergeant de notre patrimoine génétique. Sans doute, comme l’a reconnu Malraux,"l'intemporel non plus n'est pas éternel", mais l’œuvre d’art est tout de même un des rares moyens, et peut-être le plus fiable, dont dispose l’homme pour incarner ses questionnements et ses tentatives de réponse.
François-Bernard Mâche, 1er novembre 2012

Pour en savoir plus
- Références des extraits musicaux de François-Bernard Mâche, choisis par ses soins que vous pouvez entendre dans cette retransmission, avec l'autorisation du Groupe de Recherches musicales de l'INA et de l'Ensemble Accroche Note ainsi qu'avec l'aimable autorisation des Éditions Durand (Universal Musique Publishing Classical) :
- François-Bernard Mâche, Sopiana : INA-GRM CD C 1018 275192, © Avec l'aimable autorisation des Éditions Durand (Universal Musique Publishing Classical)
- François-Bernard Mâche, Kubatum : Assai 222192-MU750, repris par L'empreinte digitale ED13228, © Avec l'aimable autorisation des Éditions Durand (Universal Musique Publishing Classical)
- François-Bernard Mâche, Andromède : Radio-France CD MFA 216034, © Avec l'aimable autorisation des Éditions Durand (Universal Musique Publishing Classical)
- François-Bernard Mâche, Kassandra : INA-GRM Musidisc 292602, © Avec l'aimable autorisation des Éditions Durand (Universal Musique Publishing Classical)
- François-Bernard Mâche, Planh : hors-commerce, © Avec l'aimable autorisation des Éditions Durand (Universal Musique Publishing Classical)
- François-Bernard Michel sur le site de l'Académie des Beaux-arts
- François-Bernard Mâche sur le site de l'Académie des beaux-arts
Retrouvez sur Canal Académie les émissions liées à cette journée du 28 novembre 2012 :
-Exceptionnel ! Partagez une Journée à l’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS avec François-Bernard Michel
-Une Journée à l’Académie des beaux-arts : avec le sculpteur Claude Abeille
Très prochainement sur le site de Canal Académie, vous pourrez écouter les autres interventions des membres et correspondants de l'Académie des beaux-arts.
- Une journée à l’Académie des beaux-arts
Le mercredi 28 novembre, une journée de communications et de débats sur les rapports que l’Académie des beaux-arts entretient avec la création aujourd’hui.
Une journée à l’Académie des beaux-arts / Débats
- Le Programme du 28 novembre
9h30 Ouverture de la journée par Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts
10h « L’Académie des beaux-arts se présente » par Lydia Harambourg (correspondant de la section de peinture) et Robert Werner (correspondant de la section d'architecture)
14h30-17h « L’Académie des beaux-arts et la création aujourd’hui ».
Débat animé par Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, avec les interventions de :
Claude Abeille, sculpteur, graveur, membre de la section de sculpture : « L’Homme qui marche ! »
François-Bernard Mâche, compositeur, musicologue, membre de la section de composition musicale : « L’œuvre d’art est-elle obsolète ? »
François Chaslin, critique d’architecture, correspondant de la section d'architecture : « L’architecture, entre coups d’éclats et éclatement »
Bernard Perrine, photographe, éditeur associé du Journal de la Photographie, correspondant de la section photographie : « La photographie, entre modèle et banalité »
Pierre Carron, peintre, membre de la section peinture : « Hier encore, que faire ?»
17h : Conclusion par le Professeur François-Bernard Michel, Président de l’Académie des beaux-arts